Une figure saint-vérannaise disparaît. Homme d’église passionné d’histoire locale, André Martinais est mort à 90 ans. Michel Jolland et Jacques Roux témoignent.
Souvenirs des jours heureux sur le chemin de l’école
par Jacques Roux
Jusqu’au terme de sa vie André Martinais aura gardé vivace la mémoire de son Eden à lui, Rossat, Saint-Vérand, son paradis pas vraiment perdu puisque recomposé chaque fois que, sous un prétexte ou un autre, l’occasion lui était donnée de prendre la parole ou la plume pour l’évoquer. Ces occasions ne manquèrent pas lorsque fut créée l’association « Saint-Vérand Hier et Aujourd’hui » : Michel Jolland avait su dénicher dans un tiroir, à la mairie du village, un manuscrit que le bon père avait autrefois confié à Dieu sait qui (voir ci-dessous : Michel Jolland, « Notre village de naissance et de coeur »). Il faut reconnaître que son Dieu avait su attendre la bonne occasion et le bon lecteur pour favoriser la découverte. Car Michel Jolland fut séduit par cette analyse, parfois fantaisiste, mais troublante car ramenant sur le devant de la scène avec émotion et une certaine fraîcheur poétique, faite de naïveté et de roublardise (en ce sens André Martinais relevait bien du Saint-Vérand rustique qui forme son horizon : celui des années 1950, digne en tout point du Sainte-Sévère de Tati qu’on voit dans « Jour de Fête »), tout un « pays », hommes et paysages mêlés.
Du coup Michel Jolland voulut donner à ce texte la visibilité dont on l’avait privé et il s’approcha de l’auteur avec qui il lia une de ces belles amitiés intergénérationnelles qui laissent de côté les origines, les croyances, tout ce bazar qu’on croit important et qui brouille notre vrai rapport à la vie : ce qu’on aime, ce qui nous fait vibrer, tout le magma de nos sensations, nos émotions, nos rêveries.
Et il rendit à André Martinais le goût d’écrire et de raconter !
La suite (leur amitié et les productions qui en résultèrent) nous laissons à Michel Jolland le plaisir de le raconter. Pour notre part, nous nous contenterons de conserver d’André Martinais (prêtre qui dit sa première messe à Saint-Vérand mais ne fut jamais curé en son village) l’image d’un homme que sa jeunesse avait enchanté. Un enchantement digne des fées les plus bienveillantes : il aimait sans doute plus que tout son plateau de Rossat, les champs, les taillis, l’horizon ouvert, et les combes, les chemins creux qu’il fallait emprunter pour aller à l’école. Nulle part mieux que dans le texte dont nous avons extrait le titre de ce billet, décrivant la grande aventure du trajet vers l’école, et du retour le soir, il ne dit cet amour d’une nature alors exubérante, d’un travail de la terre exigeant mais paisible, d’un mode de vie qu’on croirait sorti non du réel mais des livres qu’on donnait aux enfants en ce temps-là – aujourd’hui on leur offre des consoles de jeux – pour leur apprendre « les choses de la vie ». Il portait sur le visage, jusqu’à ses dernières causeries publiques, alors qu’il était déjà quasi aveugle, la sérénité souriante, généreuse et confiante, héritée de ce temps lointain.
Un temps si lointain et si proche, ignorant le vacarme des « infos en continu » et la bave des « réseaux sociaux », sans doute aussi mesquin, jaloux, mauvaise langue (les humains ne sont que des humains !) mais à la bonne franquette : à la veillée ou sur le bord du chemin, entre deux considérations désabusées et définitives sur le temps qui passe. A la paysanne. Ce mot-là avait sans doute du sens pour André Martinais puisque son monde, qu’il s’efforça de décrire et faire revivre, était celui des petits paysans, avec sa dure tâche toujours recommencée, suivant le rythme des saisons, en fonction des forces, des moyens (les sous, les outils, la famille), un monde où tout était à sa place, le malheur y compris, avec Dieu tout là-haut comme ultime garantie.
Il a sans doute, dans ses derniers instants de lucidité, vécu encore le beau rêve d’errer en ce jardin enfui : les devoirs rédigés sur la pierre au retour de l’école (voir le délicat dessin d’Elisa) avec les copains, papa dans ses champs, maman dans la maison, les champs, les bêtes, les semailles, et les moissons, la batteuse, les mondées : que d’ombres a-t-il croisées, le verbe haut, le patois obstinément accroché à la lèvre avec le mégot, et le béret sur le front en sueur, que d’ombres qu’il s’obstina à ranger sur les lignes de ses cahiers, d’une écriture parfois difficile à déchiffrer…
Que d’ombres… que son dernier soupir aura effacées à tout jamais.
La mort d’André Martinais signe la fin d’un monde : il ne restera plus pour se souvenir de sa plénitude modeste mais lumineuse, comme l’Angélus de Millet sur la cheminée autrefois, que les récits laborieusement reconstruits par un vieil homme nostalgique. Des récits qu’il nous laisse comme un témoignage suffisamment personnel pour qu’à les lire on ait le chagrin de lui et suffisamment charnu pour servir ceux qui, historiens ou sociologues, voudraient comprendre ce que furent les années 50 du XXe siècle dans les secrètes profondeurs d’un tout petit village isérois.
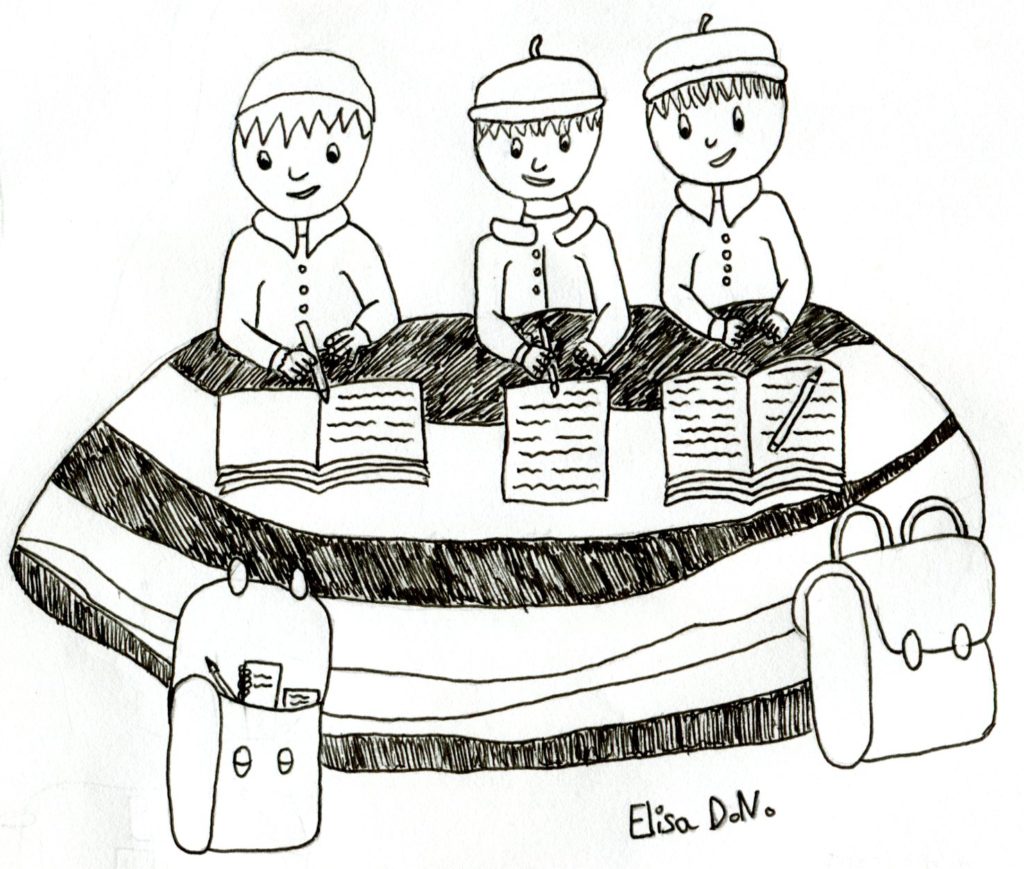
Notre village de naissance et de cœur
Évocation d’une amitié que la mort n’efface pas
par Michel Jolland
Parmi les premiers documents qu’il m’a été donné d’examiner, lorsqu’au milieu des années 2000 j’ai commencé à m’intéresser au passé et au patrimoine de Saint-Vérand (Isère), se trouvait une étude d’André Martinais sur les hameaux et les lieux-dits du village. Je connaissais André Martinais de nom, je savais qu’il était natif de Saint-Vérand et prêtre, sans plus. Ce n’est qu’après l’avoir à plusieurs reprises rencontré à Corenc, où il était curé de la paroisse, que j’ai compris que partagions non seulement la même passion pour notre village de naissance et de cœur mais aussi les mêmes centres d’intérêt : le parler local et la toponymie, les événements et les personnalités ayant marqué l’histoire lointaine ou plus récente, la vie économique et sociale des années 1940 -1970. J’ai également compris qu’il avait encore beaucoup de choses à dire sur Saint-Vérand et qu’il serait heureux de les confier à l’association dont je m’occupais alors, Saint-Vérand Hier et Aujourd’hui.

A partir de là, tout s’est enchaîné dans la confiance et la simplicité. Le 11 octobre 2008, André Martinais venait nous parler « du Saint-Vérand des années 1950 ». En janvier 2009, il devenait Membre d’honneur de l’association, le 17 octobre 2009, il évoquait « les hommes des taillis » dans le cadre d’une conférence appréciée sur le travail du bois. Dans la foulée, l’association publiait trois livrets consacrés à ses écrits : « Saint-Vérand au milieu du 20e siècle » en avril 2009, « Saint-Vérand dans les années 1950 » en octobre 2014, « Les travaux et les jours » en juin 2016. Très investi dans le travail de l’association, André Martinais participait par ailleurs à l’écriture de trois autres publications avec des contributions sur le patois et la toponymie. Le patois et ses arrière-plans linguistique et social constituaient indéniablement l’une de ses grandes passions. Comme preuve de reconnaissance pour l’intérêt porté à ce parler local, il remettait à l’association, le 23 juin 2013, l’un des ouvrages de sa bibliothèque auquel il attachait beaucoup de prix : une édition illustrée du célèbre « Grenoblo Malherou ».

Ancien professeur de lettres classique au Rondeau Montfleury à Grenoble, André Martinais avait de vastes connaissances dans les domaines de la philologie et de l’histoire religieuse. Les recherches sur Saint-Vérand ont bien sûr bénéficié de ces connaissances. Je crois cependant que ce qu’il nous a légué de plus précieux est son témoignage sur la grande mutation de la société rurale des années 1950. Pour être limité dans l’espace et dans le temps – le hameau de Rossat entre 1940 et 1970 – ce témoignage n’en est pas moins utile et riche. C’est d’abord une étonnante capacité à décrire, comme s’il était toujours là, le Saint-Vérand du milieu du siècle dernier. Le sens des situations, la profusion des détails, le recours au parler local, les clins d’œil adressés au lecteur, tous ces éléments soutiennent une réelle puissance d’évocation. Au-delà, et c’est une constante qui a de quoi frapper le lecteur, il est marqué par un regard plein de tendresse, de sollicitude et de générosité sur les hommes, sur leur travail, sur les relations qu’ils entretiennent entre eux, sur leur manière de voir le monde, un regard marqué par une part d’affectivité, de nostalgie et d’idéalisation du passé, un regard nourri de bienveillance et d’altruisme mais aussi un regard empreint d’un socle de valeurs affirmées : celles du catholicisme.
Nous n’étions pas d’accord sur tout. Chacun de nous par exemple avait de la considération pour Paul Berret, écrivain, historien, poète, journaliste, conférencier et photographe qui vécut et fut inhumé à Saint-Vérand où il prononça en 1905 un discours mémorable pour l’inauguration des écoles publiques. Je crois pouvoir dire qu’André Martinais ne partageait pas mon enthousiasme pour ce discours au laïcisme retentissant. Il n’empêche, et je l’évoque ici avec émotion, qu’une sorte de complicité nous unissait lorsque nous abordions, souvent de manière indirecte et allusive mais toujours en pleine conscience des enjeux du débat, la question des relations entre les engagements revendiqués et leur mise en pratique dans la vie de tous les jours. A ce propos, André Martinais faisait volontiers le détour par une question qui, derrière l’apparence du mot d’esprit sans prétention, ouvre, pour qui veut bien y réfléchir, sur des interrogations vertigineuses : « Combien de temps durent les regrets éternels qui fleurissent sur les plaques des cimetières ? ». Une manière subtile de suggérer que l’être humain a parfois plus de facilité à afficher des valeurs qu’à les incarner.

