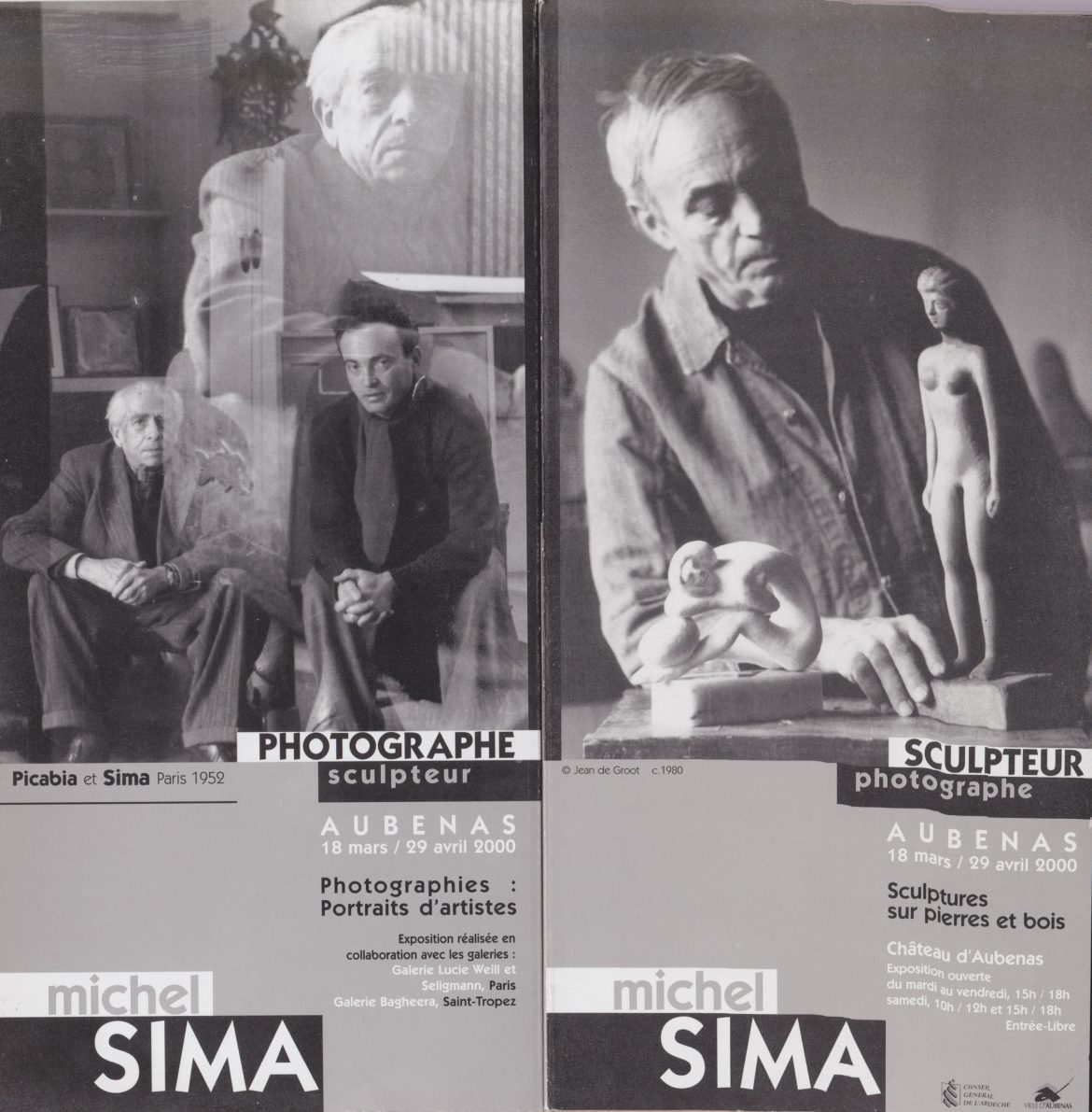Les « Demoiselles du Champ d’en-haut »

Par Michel Jolland
Après l’étude passionnante et fort bien documentée proposée par Jacques Roux sur les Romances de Noël, je reviens – « sans transition » selon l’expression habituelle des journalistes de télévision – à un sujet souvent évoqué dans ces pages : mon enfance au Barret dans les années 1950. La modeste propriété de mes grands-parents dépassait à peine deux hectares, répartis sur quatre sites : il y avait « la maison », « le bois », « le champ d’en-bas » et le « champ d’en-haut ». Peut-être parce que c’était le plus éloigné de l’habitation, peut-être aussi parce qu’il affichait une topographie particulière, le « Champ d’en-haut » véhiculait à mes yeux d’enfant un parfum d’exotisme et d’aventure. Il faut dire que c’est celui que je fréquentais le moins car il se prêtait peu à l’une des mes activités régulières, fort joliment décrite par cette expression usuelle du parler rural de l’époque : « aller en champ aux chèvres ». L’atout essentiel du Champ d’en-haut était d’incarner une sorte de Pays de Cocagne où, en toute saison, on trouvait des fruits, des baies, des fleurs à cueillir. Le plus souvent, il s’agissait de ressources qui s’étaient installées là, probablement pour de bonnes raisons mais sans intervention humaine directe. Je me souviens en particulier des pommes très petites produites par des arbustes non cultivés, des pommes qu’en toute bonne foi nous appelions des « Demoiselles ». Soixante-dix ans plus tard le doute s’intalle : cette appellation était-elle bien légitime ? Ne s’agissait-il pas plutôt d’une innocente fantaisie de langage, fort heureusement sans conséquence connue à ce jour sur la vie du quartier du Barret ou sur celle de la commune de Saint-Vérand !
POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUER SUR L’IMAGE